LÕenfant gueri du cancer
DÕaprs
un expos du Dr Jean Michon
Chef du dpartement dÕOncologie Pdiatrique de
lÕInstitut Curie
Prsident du rseau dÕhmatologie et dÕoncologie
Pdiatrique dÕIle de France (RIFHOP)
Sance
de FMC du 16 septembre 2010
1. Genralits
Les cancers de lÕenfant prsentent des caractristiques propres qui les distinguent des tumeurs de lÕadulte. Les tissus tumoraux de lÕenfant prsentent souvent des similitudes avec les tissus embryonnaires et fÏtaux. De plus, des arrts spontans de la croissance tumorale sont par ailleurs observs dans certains types de tumeurs de lÕenfant (hmangiomes, neuroblastomes de stade IV, rsidus nphrogniques) pouvant faire voquer un arrt programm de cette croissance.
Une mme tumeur maligne peut prsenter des composantes pluritissulaires faisant voquer la notion de cellules souches pluripotentes leur origine.
Les cancers de lÕenfant se dveloppent prfrentiellement au dpend dÕorganes ou de tissus en dveloppement ou forte croissance.
2. Quelques chiffres sur les cancers survenant pendant lÕenfance
2.1. Epidmiologie
2.1.1. Les chiffres
Les cancers de lÕenfant sont des maladies rares et ne reprsentent quÕun pourcent de lÕensemble des noplasies. Cependant, chaque anne environ 1 500 enfants de moins de 15 ans sont atteints par ces pathologies en France.
|
Incidence / million dÕenfants <15 ans |
110 150 nouveaux cas |
|
Risque de survenue < 15 ans |
1/600 |
|
Risque de survenue < 25
ans |
1/285 |
|
% des dcs
pdiatriques (< 15 ans) |
10 % |
|
Mortalit < 15 ans pays dvelopps |
2me rang aprs les accidents |
|
Adultes (16-44 ans)
guris dÕun cancer dans lÕenfance |
1/800 |
2.1.2. Quel ge ?
Toutes les tudes montrent deux pics dÕincidence, de la naissance 3 ans et de 15 20 ans.
Les cancers de lÕenfant sont en augmentation sensible, 1 3 % par an, dans les dernires dcennies la fois en Europe et en Amrique du Nord.
En France, la progression est forte chez les enfants de moins de 5 ans, un peu moins marque chez ceux de 5-9 ans et chez ceux de 10-14 ans. De plus, la progression est un peu plus marque chez les garons dont le taux dÕincidence a progress de 1,4% par an [0,3 ; 2,6] que chez les filles dont le taux a progress de 0,9% par an [-0,4 ; 2,2].
Ces donnes sont prsentes sur le graphe suivant (Lancet 2004; 364: 2097–105).
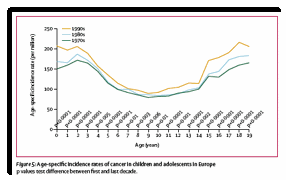 .
.
2.1.3. Quelles localisations ?
Une rpartition, en termes de localisation de cancer totalement diffrente.
LÕincidence des principales localisations partir de 2 registres nationaux-(2000-2003) est de 1600 cas nouveaux par an, 900 cas chez les garons et 700 cancers chez les filles.
En termes dÕincidence annuelle de type de cancer, les chiffres sont les suivants :
á Hmopathies malignes : 40%
o Leucmies : 460 cas/ an, surtout lymphoblastiques affectant la ligne B
o Lymphomes : 185 cas/an (deux fois plus frquents chez les garons)
á Tumeurs solides
o Tumeurs systme nerveux : 500 cas/an
o Tissus mous : 105 cas/an
o Neuroblastomes : 95 cas/an
o Ostosarcomes : 85 cas/an
o Autres : 175 cas/an dont 50 rtinoblastomes
A titre dÕillustration, le tableau ci-dessous prsente les principaux cancers en 2003 chez les Franciliens de moins de 15 ans
|
Cancers
IDF en 2003 |
Garons |
Filles |
|
|
Nombre total Taux standardis pour
100 000 enfants |
N=192 16,8 |
N=135 12,3 |
|
|
Leucmies LNH Tumeurs SNC Cancers du rein Autres cancers |
23 % 17 % 16 % 9 % 35 % |
22 % 13 % 17 % 8 % 40 % |
|
LÕvolution des taux dÕincidence (chiffres de lÕIle de France)
Le taux dÕincidence des leucmies est stable pour les deux sexes.
Les lymphomes malins sont en progression chez les garons (+3,8% par an [0,6 7,2]) mais quasiment stables chez les filles (+0,6% par an [-4,4 5,8].
Les tumeurs du systme nerveux central augmentent plus fortement chez les filles (+2,4% par an [-0,8 5,7]) que chez les garons (+1,3% par an [-1,5 4,1]).
Le cancer du rein est en progression chez les enfants des deux sexes et chez les filles, le taux dÕincidence de ce cancer dpasse celui des lymphomes non hodgkiniens depuis le dbut des annes 90.
Les Òautres sitesÓ, qui regroupe tous les autres cancers, est galement en progression notamment chez les garons (+1,6% par an [0,4 2,8]).
Source: pidmiologie des
cancers chez lÕenfant de moins de 15 ans en ële-de-France - Observatoire
rgional de sant d'ële-de-France (Judith Dulioust, Philippe Ppin, Isabelle
Grmy)
2.2. Quelles localisations en fonction de lÕge ?
La rpartition par sous-type de tumeur en fonction des classes dÕge et prsente dans le tableau ci-dessous (Lancet 2004; 364: 2097–105).

2.3. Le pronostic
2.3.1. La mortalit
Il y a de 300 350 dcs/an par cancer entre 0 et 15 ans. CÕest la 2me cause de mortalit entre 1 et 15ans aprs les accidents.
Ce taux est globalement en baisse, sauf pour les tumeurs crbrales. Il est pass de 5,5 3,2 dcs par an pour 100 000 enfants de moins de 15 ans entre 1981 et 2002, enregistrant une baisse annuelle moyenne de 2,6%. Cependant, depuis une dizaine dÕannes, ce taux est en plateau.
Les taux de mortalit chez les Franciliens gs de moins de 15 ans est de 3,2 dcs annuels pour 100 000 enfants [2,7 ; 3,6].Ce taux est de 3,4 chez les garons [2,8 ; 4,0] et de 2,9 chez les filles [2,3 ; 3,5].
Les tumeurs du systme nerveux central et les leucmies sont les principales causes de dcs par tumeurs chez les moins de 15 ans. Les tumeurs du systme nerveux central sont lÕorigine de prs dÕun tiers des dcs par tumeur chez lÕenfant.
2.3.2. La survie
La survie globale est passe, pour la priode 1987-1992 de 71 77 % pour la priode 1996-1999. La survie dix ans par localisation est la suivante chez les enfants de moins de 15 ans :
á Hmopathies malignes
o Leucmies : 71 % (LAM : 50 %)
o Lymphomes : 87 % (NHL : 75 %)
á Tumeurs solides
o SNC : 61 % (de 43 75 %)
o SNS : 68 %
o Tissus mous : 65 %
o Neuroblastomes : 86 %
o Ostosarcomes : 64 %
o Rtinoblastomes : 97 %
Le taux de dcs iatrognes prcoces (<5ans) est, lui aussi, en baisse passant de 8 % en 1987 4 % en 1999.
Ces chiffres doivent tre nuancs car sÕil y 90% des survivants 5 ans guris, le risque pour ces enfants de dvelopper un second cancer dans les 25 ans est multipli par de 4 6 fois.
Bien quÕil nÕy ait pas de risque accru de malformations ou cancers la gnration suivante, il existe un risque suprieur dans la fratrie, surtout pour les leucmies prcoces
2.3.3. Des ingalits persistentÉ
Enfin, il y a plus de survivants dans les pays plus avancs au plan conomique, comme le montre les courbes suivantes (Lancet 2004; 364: 2097–105).

3. Plus de survivants : enjeux sur des organes en croissance
3.1. Le contexte
LÕamlioration du taux de gurison des patients atteints de cancer dans lÕenfance implique que de plus en plus de patients considrs comme guris doivent tre pris en charge en mdecine dÕadulte, souvent en mdecine interne, pour surveillance, prise en charge de squelles, ou pour des problmes de sant intercurrents. Au moins un jeune adulte de 21 ans sur 1000 est un survivant de cancer de lÕenfance! La rsultante est quÕil faut poursuivre lÕamlioration de la survie et limiter la toxicit des traitements.
3.2. Intrt d'un suivi long terme
Le suivi de ces anciens malades comporte des examens de surveillance de la maladie, qui sÕespacent avec le temps qui passe aprs lÕarrt du traitement, des examens de surveillance des ventuelles squelles physiques et physiologiques (croissance, audition, apprentissagesÉ) et une dtection des ventuelles consquences psychosociales de la maladie, parfois tardives. Enfin, il est utile, chez lÕancien malade devenu jeune adulte, de reprendre toute son histoire avant de lui donner les conseils de surveillance long terme, et dÕhygine de vie.
Le suivi long terme, alors que les patients sont souvent considrs comme guris, a plusieurs objectifs.
á L'un d'eux consiste dpister une ventuelle rcidive tardive de la maladie. Mme si les rechutes sont rares aprs ce dlai, elles expliquent 75 % des dcs survenant 5 10 ans aprs le diagnostic et 35 % des dcs aprs 10 ans de recul.
á LÕautre est la dtection de la survenue ventuelle d'effets secondaires tardifs aprs les traitements.
3.3. Les squelles les plus frquentes
Les plus frquentes, sont de nature endocrinienne, dficit en hormone de croissance, hypothyrodie, dficit gonadique. Ensuite, on retrouve
á Des squelles orthopdiques pour les patients traits pour tumeurs osseuses ou neuroblastomes (cyphoscoliose, amyotrophie, ankyloses, ingalit de longueur des membres infrieurs, É)
á Des squelles neurologiques ou psychiatriques, parfois associes
á Des squelles cardiaques (myocardiopathies post-anthracyclines)
á Des seconds cancers
3.4. La chimiothrapie
3.4.1. Les anthracyclines & le coeur
La famille
Cette famille de substances intercalantes comprend la daunorubicine (Crubidine/Daunoxomeª), Doxorubicine/adriamycine (Adriblastineª, Caelyxª), pirubicine (Farmorubicineª), idarubicine (Zavedosª), pirarubicine (Thprubicineª) et les anthracnediones, mitoxantrone (Novantroneª)
La toxicit long terme
Toute cette famille de mdicaments est associe une toxicit cardiaque dose-dpendante ds la premire administration en raison dÕune rarfaction des fibres myocardiques quÕelle induit.
3.4.2. Les alkylants
La famille
Les agents alkylants forment, aprs mtabolisation et formation d'ions carbonium trs ractifs, des liaisons covalentes avec les acides nucliques.
Cette famille comprend
á Les moutardes azotes, mechlorthamine (Caryolysineª), cyclophosphamide (Endoxanª), ifosfamide (Holoxanª), melphalan (Alkranª), chlorambucil (Chloraminophneª), l'hexamthylmlamine (Hexastatª), le busulfan (Mylranª) ou la dacarbazine (Dticneª) ou la procarbazine (Natulanª)
á Les nitroso-ures, comme la lomustine
Les effets secondaires long terme
Ils sont responsables dÕune diminution de la fertilit presque constante et augmente le risque de leucmies secondaires
3.4.3. LÕtoposide
Il bloque la synthse de la chane ADN par inhibition des topoisomrases II, mais aussi par un blocage fonctionnel des mitochondries.
Il est associ un risque de leucmies secondaires.
3.5. La radiothrapie
3.5.1. LÕIrradiation du SNC
Le contexte
La toxicit radio-induite du systme nerveux central est explique selon deux modles physiopathologiques : lÕhypothse parenchymateuse (absence de rgnration des oligodendrocytes et une dmylinisation de la substance blanche) et lÕhypothse vasculaire (dommages vasculaires radio-induits responsables dÕune ischmie et donc dÕune ncrose secondaire de la substance blanche
Le systme nerveux central est un tissu faible renouvellement cellulaire. Dans les tissus faible taux de prolifration, le principal mcanisme de lutte contre les dommages radio-induits est la rparation des lsions de lÕADN. Contrairement aux tissus renouvellement rapide, le mcanisme de repopulation pendant lÕirradiation est peu important, il survient aprs une longue priode de latence. Cela explique pourquoi des consquences tissulaires sont observes des mois ou des annes aprs la radiothrapie, lorsque les cellules se diffrencient et meurent lors de leur division cellulaire.
La toxicit limitante de lÕirradiation crbrale est sa neurotoxicit tardive, qui peut tre responsable dÕune dgradation neurocognitive, dÕune ncrose crbrale, dÕune leucoencphalopathie ou dÕatteintes vasculaires.
Les troubles endocriniens
Le systme hypothalamo-hypophysaire peut tre atteint de faon transitoire ou dfinitive au cours dÕirradiations crbrales ou portant sur la base du crne. Ces atteintes portent essentiellement sur lÕhormone de croissance. Lorsque le dficit est profond, il est lÕ origine dÕun trouble de croissance sÕaccentuant avec le temps sÕil nÕest pas corrige.
Les troubles neuro-cognitives
Ce sont des dgradations des fonctions suprieures constates par rapport une population de sujets sains. Cette dgradation se manifeste de faon variable selon les individus par des troubles de lÕattention, de la mmoire, de la motricit ou un ralentissement psychomoteur. Chez les enfants, la toxicit neurologique tardive radio-induite est dose-dpendante et dÕautant plus svre que la radiothrapie est dlivre avant cinq ans, quand les tissus nerveux sont encore en cours de dveloppement
3.5.2. lÕIrradiation en gnral
Elle est responsable de seconds cancers. Il peut sÕagir de tumeurs osseuses dans le cas de rtinoblastome ou de tumeur Ewing.
Dans le cas dÕirradiation thoracique (maladie de Hodgkin), il existe une atteinte des bourgeons mammaires et une augmentation du risque de cancer du sein. Elle est fonction de la dose reue. Dans lÕtude EURO2K, 57 cancers du sein ont t observs chez 1871 survivantes 5 ans dÕun cancer solide de lÕenfant.
3.6. Les complications cardiAques
Les pathologies cardiovasculaires sont les causes non cancreuses les plus frquentes trs long terme aprs traitement dÕun cancer de lÕenfant. Le risque de dcs global est huit fois plus lev que dans la population gnrale.
Le risque de dcs d aux maladies cardiaques augmente avec, la dose dÕanthracyclines, et lÕadministration des agents alkylants et/ou de vinca alcalodes.
De mme, ce risque augmente fortement avec la dose de rayonnement reu au cÏur ; il est 14,5 (95 % IC : 2–291) fois plus lev chez les patients ayant reu une dose au cÏur entre 5 et 15 Gy par rapport aux patients nÕayant pas t exposs.
La radiothrapie augmente le risque de dcs par maladies vasculaires, en particulier lorsque le cerveau a reu des hautes doses de rayonnement.
3.7. Les autres complications
Les problmes post-chirurgicaux et post-tumoraux, soit de type neurologique soit de type orthopdique sont prendre en compte et suivre.
3.8. quid de la gurison psychique du cancer ?
Le cancer impose aux enfants un traumatisme psychique norme qui ncessite sa prise en compte par lÕensemble de lÕquipe soignante, mais galement des soins psychiques spcialiss, parfois brefs, parfois au long cours.
LÕintervention psychiatrique value les dfenses psychiques de lÕenfant, ses angoisses, dÕventuels symptmes dpressifs, mais galement la survenue de difficults scolaires et de difficults de communication entre les diffrents membres de la famille (parents, enfant, fratrie).
Il nÕest pas rare que lÕquilibre affectif du couple parental soit mis mal et que les membres de la fratrie du malade, laisse pour compte, aillent mal.
4. Conclusion
Les axes suivis pour amliorer la quantit et la qualit de la survie sont les suivants :
á Amlioration de la documentation des sous-types des maladies, comme pour le neuroblastome
o Ç Dsescalade È pour les meilleurs cas sur la base dÕun diagnostic molculaire prcoce
o Ç Escalader È pour les moins bon cas (signature gnomique : quasi au point)
á
Explorer, comme en oncologie
adulte, les voies de signalisation pour cibler les cellules tumorales
Annexe I
|
Organes |
Agents en cause |
Facteurs favorisants |
|
|
CÏur |
Cardiomyopathie congestive |
Anthracyclines, cyclophosphamide Radiothrapie mdiastin |
Dose cumulative leve, jeune ge |
|
Poumons |
Fibrose |
Blomycine, busulfan, BCNU Radiothrapie |
Dose cumulative leve |
|
Rein |
Tubulopathie, HTA, insuffisance rnale |
Radiothrapie Ifosfamide, cisplatine |
Rein unique ou nphrectomie, autres |
|
Vessie |
Fibrose |
Cyclophosphamide, ifosfamide Radiothrapie |
mdicaments nphrotoxiques |
|
Gonades |
Hypogonadisme |
Alkylants |
Plus important chez les garons, dose leve |
|
Mnopause prcoce chez les femmes,
hypofertilit |
Radiothrapie (gonades et/ou encphale) |
|
|
|
Pubert, croissance staturo-pondrale |
Pubert prcoce |
Radiothrapie encphale |
Jeune ge |
|
Corticothrapie |
|
||
|
Thyrode |
Hypo- ou hyperthyrodie |
Radiothrapie |
|
|
Appareil
locomoteur |
Chirurgie |
||
|
Dformations musculo-squellettiques |
Radiothrapie |
|
|
|
Ostopnie |
Corticothrapie |
|
|
|
Ncrose aseptique |
|
|
|
|
SNC |
Troubles cognitifs |
Radiothrapie encphale |
Dose leve et jeune ge |
|
SNP |
Neuropathies sensitives |
Cisplatine |
Dose dpendant |
|
|
Dficit auditif |
|
|
|
Yeux |
Cataracte |
Radiothrapie Corticothrapie Busulfan |
|
Annexe II
Rseau d'Ile-de-France d'Hmatologie-Oncologie Pdiatrique (RIFHOP) Prsentation
ONCORIF est le rseau rgional de cancrologie dÕële-de-France cr en 2006.
Il fdre lÕensemble des acteurs de la cancrologie en ële-de-France dans le but de favoriser une prise en charge du cancer de qualit, globale et homogne dans la rgion.
Il associe les rseaux de cancrologie, les rseaux de soins palliatifs, les fdrations hospitalires, les centres franciliens de lutte contre le cancer, l'AP-HP, les mdecins libraux (URML) et les usagers (CISS).
Missions
ONCORIF a un rle transversal de coordination, de valorisation et mise en cohrence des actions, de recueil dÕinformations et de centre de ressources :
Il fdre lÕaction des rseaux territoriaux et thmatiques grce des actions de communication, de mise disposition de ressources et de partage d'expriences entre rseaux,
Il diffuse les ralisations faites par ces rseaux : fiches mdicaments, guidesÉ
Il rassemble des informations pratiques sur la cancrologie francilienne : liste des Centres de Coordination en Cancrologie (3C), des runions de concertation pluridisciplinaire (RCP), des formations, etc...
Il produit des ressources et des outils de communication communs : rfrentiels, DCC, site InternetÉ
Il est financ par la Mission Rgionale de Sant (MRS) et soumis aux recommandations de lÕInstitut National du Cancer.
Coordonnes
ONCORIF
3/5 rue de Metz - 75010 Paris
Tl : 01 48 01 90 20
Fax : 01 48 01 98 30
E-mail : contact@oncorif.fr